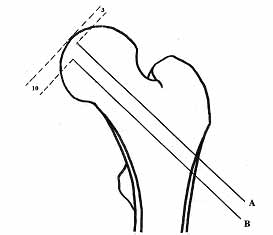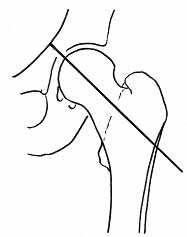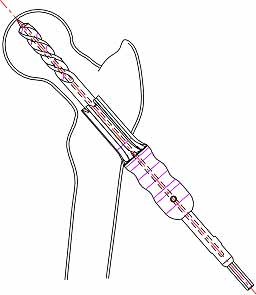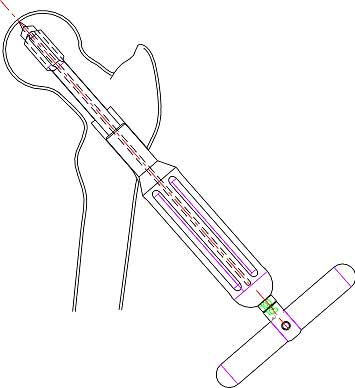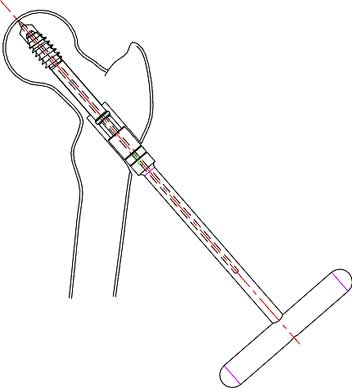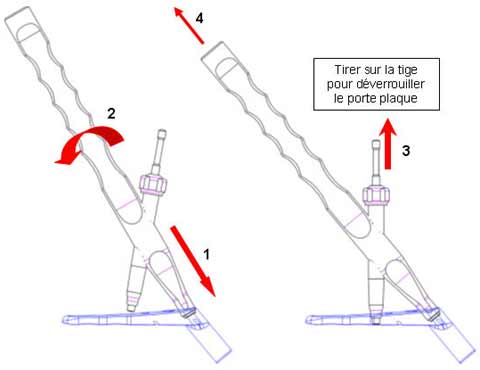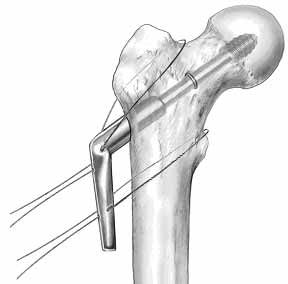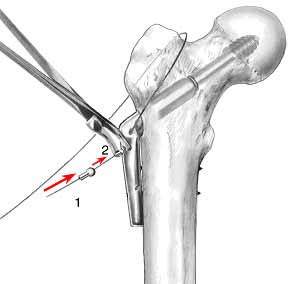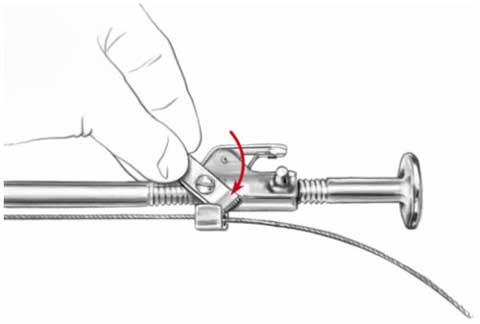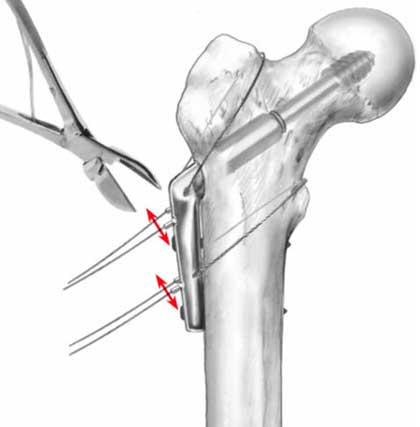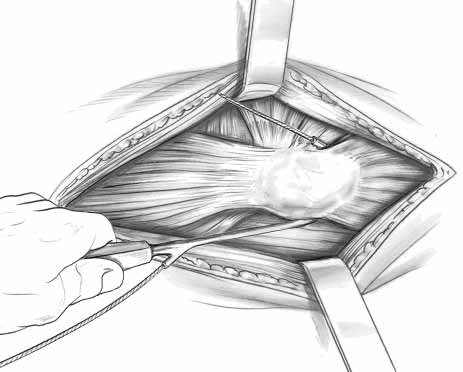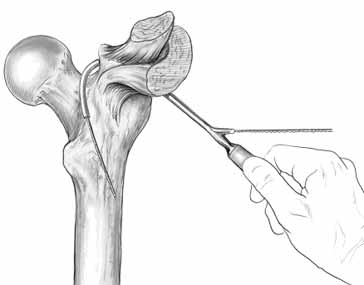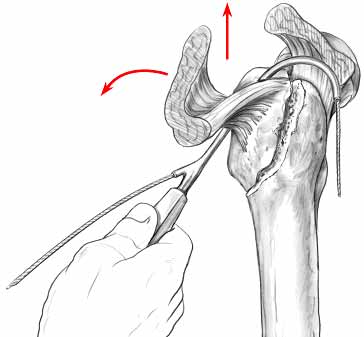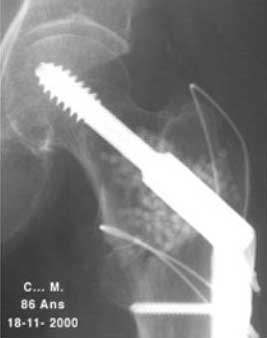Technique
opératoire
Un matériel stabilisé
pour une hanche dynamique
Destiné au traitement des fractures
stables et instables du tiers supérieur du fémur
Introduction
 Implant
utilisé pour stabiliser les fractures trochantérienne,
sous trochantérienne et trochantéro-diaphysaire
instables du tiers supérieur du fémur. Après
réduction, la stabilité du montage maintient
la réduction obtenue. Anatomie respectée avec
restitution de la fonction initiale. Implant
utilisé pour stabiliser les fractures trochantérienne,
sous trochantérienne et trochantéro-diaphysaire
instables du tiers supérieur du fémur. Après
réduction, la stabilité du montage maintient
la réduction obtenue. Anatomie respectée avec
restitution de la fonction initiale.
 La
gravité des fractures trochantériennes survenant
chez les personnes âgées tient à la quantité
d’os cortical mais surtout d’os spongieux qu’elles
ont perdu au moment de la fracture du fait de la maladie ostéoporotique. La
gravité des fractures trochantériennes survenant
chez les personnes âgées tient à la quantité
d’os cortical mais surtout d’os spongieux qu’elles
ont perdu au moment de la fracture du fait de la maladie ostéoporotique.
Il existe un rapport étroit entre la complexité
de la fracture et la perte osseuse. L’amincissement
des corticales, l’impaction de l’os spongieux
lors de la chute entraînent une instabilité d’autant
plus grande que l’on ne peut reconstruire ni la plaque
trochantérienne postérieure lorsqu’elle
est fragmentée, ni l’os spongieux après
son impaction. Cette instabilité est encore plus marquée
lorsque le pilier interne fracturé ne peut être
reconstruit en raison d’un hiatus osseux lié
à l’alignement du petit trochanter. La gravité
tient aussi à la fréquence (70%) des séquelles
fonctionnelles qui peuvent laisser une boiterie, une impossibilité
à la montée ou à la descente des escaliers
lorsque les tubérosités sont fracturées.
Elles sont alors en quelque sorte « abandonnées
» tant leur ostéosynthèse est difficile
voir impossible. Nous avons donc tenté de palier ces
inconvénients de la façon suivante :
 Nous
avons décidé de ne plus tenir compte dans la
stabilisation du foyer de la fracture de la plaque trochantérienne
postérieure. Celle-ci n’est jamais ostéosynthésable. Nous
avons décidé de ne plus tenir compte dans la
stabilisation du foyer de la fracture de la plaque trochantérienne
postérieure. Celle-ci n’est jamais ostéosynthésable.
Nous avons décidé de combler le vide méthaphysaire
inévitable une fois le foyer de fracture réduit
par un bio matériau (offrant
une résistance mécanique suffisante).
 Nous
avons opté pour une fixation per-primam des deux tubérosités,
le petit et le grand trochanter, pour tenter de minimiser
les séquelles fonctionnelles. Nous
avons opté pour une fixation per-primam des deux tubérosités,
le petit et le grand trochanter, pour tenter de minimiser
les séquelles fonctionnelles.
Afin de réaliser ces objectifs, il convient de disposer
d’un matériel d’ostéosynthèse
fiable en se plaçant du double point de vue biologique
et mécanique.

Information du patient et précautions
à prendre par le patient
 Depuis
1990 nous autorisons la mise en charge précoce du patient.
Elle se fait au bout de 8 à 10 jours. Le patient déambule
sans limitation de quantité d’appui. La marche
en effet ne peut s’effectuer en appui monopodal , d’une
façon générale les patients du troisième
et quatrième âge n’ont pas la force nécessaire
pour sauter à cloche-pied, en plus ils n’ont
pas la force nécessaire dans les bras pour supporter
la charge du corps lors de la phase de balance lorsque l’appui
du côté fracturé n’est pas autorisé. Depuis
1990 nous autorisons la mise en charge précoce du patient.
Elle se fait au bout de 8 à 10 jours. Le patient déambule
sans limitation de quantité d’appui. La marche
en effet ne peut s’effectuer en appui monopodal , d’une
façon générale les patients du troisième
et quatrième âge n’ont pas la force nécessaire
pour sauter à cloche-pied, en plus ils n’ont
pas la force nécessaire dans les bras pour supporter
la charge du corps lors de la phase de balance lorsque l’appui
du côté fracturé n’est pas autorisé.
 La
quantité de marche est variable dans le temps et pour
chaque patient. Elle augmente progressivement. Plus le patient
est actif, plus la récupération sera rapide. La
quantité de marche est variable dans le temps et pour
chaque patient. Elle augmente progressivement. Plus le patient
est actif, plus la récupération sera rapide.
 Le
patient ne peut pas appuyer sur un membre fracturé
douloureux. L’ostéosynthèse ne permet
l’appui que s’il est indolore ce qui oblige à
une immobilisation aussi stable que possible au niveau du
foyer principal et des foyers secondaires. Le
patient ne peut pas appuyer sur un membre fracturé
douloureux. L’ostéosynthèse ne permet
l’appui que s’il est indolore ce qui oblige à
une immobilisation aussi stable que possible au niveau du
foyer principal et des foyers secondaires.
Nous devons ainsi stabiliser le fragment cervico-céphalique
en le solidarisant au fragment métaphyso-diaphysaire
à l’aide d’un matériau métallique
stabilisé et d’un éventuel comblement
greffe.
Nous devons stabiliser le grand et le petit trochanter à
l’aide de câbles solidarisés à la
vis-plaque.
| Complications |
Pseudarthrose
Hématomes
Lésions nerveuses
Thrombose |
Embolie
Intervention supplémentaire
Retrait du matériel
Mobilité, douleur |

Mise en place de la vis-plaque
 Voie
d’abord postéro-externe avec abord fémoral
en rétro-musculaire. Voie
d’abord postéro-externe avec abord fémoral
en rétro-musculaire.
L’incision sera décalée vers la fesse
si l’on veut stabiliser le grand trochanter.
L’incision sera décalée vers le genou
si l’on veut stabiliser le petit trochanter.
La réduction peut
être obtenue soit en rotation interne soit en rotation
externe. 
Mise en place des
broches
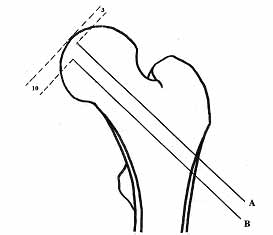 |
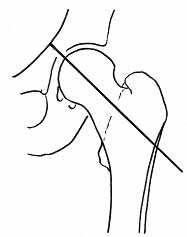 |
A : la broche de la vis plaque est
envoyée au centre de la tête fémorale.
L’extrémité de la vis céphalique
reste à 5mm environ de la périphérie
de la tête fémorale.
B : la broche du clou-plaque longe le
bord inférieur du col fémoral |
La longueur de la vis céphalique ayant été
mesurée, la broche filetée est poussée
de 10mm dans le fond du cotyle osseux où elle se
fixe solidement.
Les manœuvres instrumentales ultérieures en
seront facilitées sans craindre la mobilisation
de ce repère guide essentiel. |
Vérification des positionnements
à l'aide de l'amplificateur de brillance 
Fraisage et taraudage
 Le
fraisage chez les patients ostéoporotiques ne doit
pas aller jusqu’à l’extrémité
de la broche. La fraise est en effet cylindrique alors que
l’extrémité de la vis est tronconique. Le
fraisage chez les patients ostéoporotiques ne doit
pas aller jusqu’à l’extrémité
de la broche. La fraise est en effet cylindrique alors que
l’extrémité de la vis est tronconique.
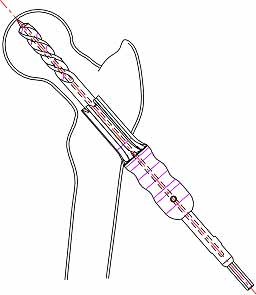 |
Si l’on fraise de la longueur exacte
de la vis,
l’extrémité du cône ne sera
pas ancrée mécaniquement dans l’os.
Il convient donc de retirer cinq millimètres
de longueur sur la fraise. |
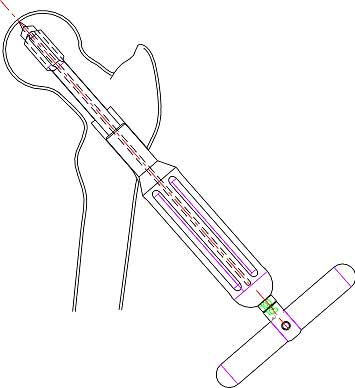 |

Insertion de la vis céphalique
 La
vis céphalique est introduite à la main à
l’aide de la clé de vissage. Elle sera de la
même longueur que celle mesurée sur la broche.
L’orientation des méplats se fait lorsque la
poignée de la clé de vissage est perpendiculaire
à l’axe de la diaphyse fémorale. La
vis céphalique est introduite à la main à
l’aide de la clé de vissage. Elle sera de la
même longueur que celle mesurée sur la broche.
L’orientation des méplats se fait lorsque la
poignée de la clé de vissage est perpendiculaire
à l’axe de la diaphyse fémorale.
 Si
l’on souhaite faire une compression lorsque le trait
de fracture pertrochantérien est unique, on peut choisir
une vis de cinq millimètres de longueur inférieure
à celle mesurée sur la broche. On pourra lors
de la solidarisation de la vis céphalique et de la
plaque tube comprimer le foyer qui ramènera la diaphyse
sur le col fémoral. Si
l’on souhaite faire une compression lorsque le trait
de fracture pertrochantérien est unique, on peut choisir
une vis de cinq millimètres de longueur inférieure
à celle mesurée sur la broche. On pourra lors
de la solidarisation de la vis céphalique et de la
plaque tube comprimer le foyer qui ramènera la diaphyse
sur le col fémoral.
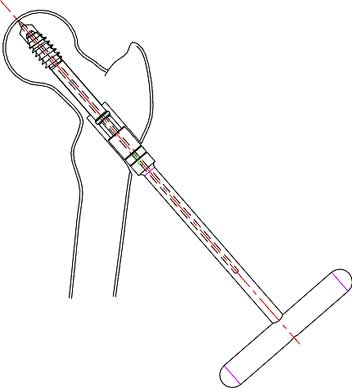

Insertion de la plaque-tube
fémorale externe
 Utilisation
du porte plaque-tube fémorale 130° Utilisation
du porte plaque-tube fémorale 130°
 Le
porte plaque-tube fémorale 130°
a 3 fonctions : la préhension, la rotation et l’impaction
des plaques tube fémorales 130°. Le
porte plaque-tube fémorale 130°
a 3 fonctions : la préhension, la rotation et l’impaction
des plaques tube fémorales 130°.
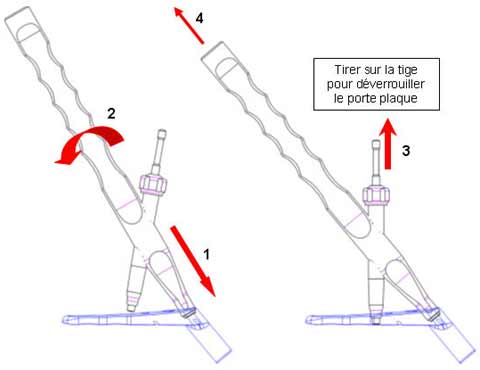

Passage du câble
dans les guide câbles puis ablation du passe câbles
 Les
câbles sont passés dans les orifices de la plaque
tube avant de la fixer sur le fémur à l’aide
de vis. Les
câbles sont passés dans les orifices de la plaque
tube avant de la fixer sur le fémur à l’aide
de vis.
On glisse la bille de sertissage sur le brin postérieur
du ou des câble(s) et, à l’aide de la pince
à sertir on matte la partie cylindrique de la bille
de sertissage que l’on amène au contact de la
plaque.
Les tubérosités sont stabilisées
en dernier lieu ; ce temps opératoire se déroule
après l’ostéosynthèse de la facture
trochantérienne par l’ensemble vis-plaque

Mise en place
du tendeur de câble
 Le
tendeur de câble est vissé sur l’ensemble
vis plaque. (A) Le
tendeur de câble est vissé sur l’ensemble
vis plaque. (A)
On glisse dans le brin antérieur du câble la
bille de sertissage puis le câble est fixé dans
le tendeur à crémaillère. (B)
A la main, on exerce la tension nécessaire pour stabiliser
les fragments osseux. La bille de sertissage est amenée
au contact de l’orifice de la plaque où elle
est matée.
| (A) |
 |
| (B) |
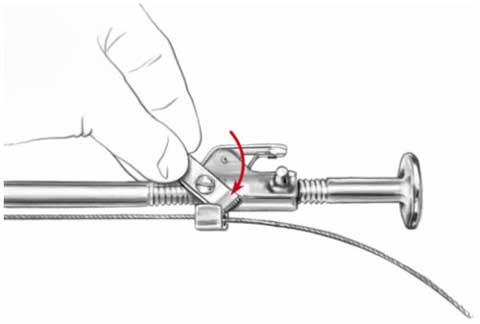 |
La tension exercée sur le câble
par l'intermédiaire du tendeur de câbles est
faite manuellement. Elle est maintenue par la crémaillère.
Lorsqu'une tension suffisante pour maintenir le câble
en rectitude, il ne faut pas chercher à atteindre le
cran de la crémaillère situé au-dessus.

Section des extrémités
du câble au ras des billes
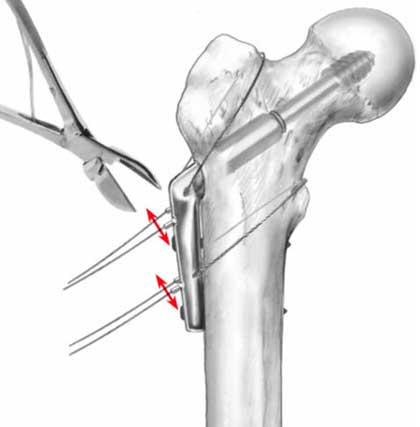

Mise en place du câble
destiné à stabiliser le grand trochanter
 Le
passe câble est passé d’avant en arrière
soit en pré-osseux (A), soit en inter tendineux (B). Le
passe câble est passé d’avant en arrière
soit en pré-osseux (A), soit en inter tendineux (B).
Lorsque le trait de fracture détache en bloc le grand
trochanter, le câble sera passé de préférence
en pré-osseux.(A)
Lorsque le trait de fracture vertical détache le grand
trochanter en deux fragments, l’antérieur reste
solidaire de la diaphyse, le postérieur est attiré
en arrière et en haut par le puissant tendon blanc
du moyen fessier. Il convient de passer le câble en
inter tendineux à la façon d’un hauban.
(B)
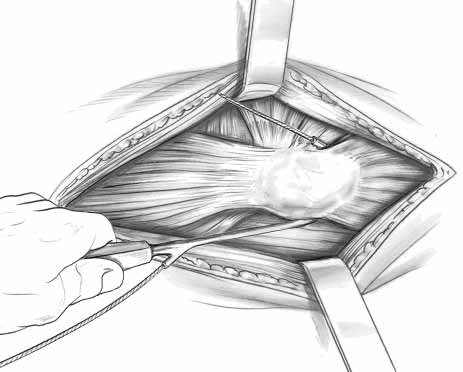
| (A) |
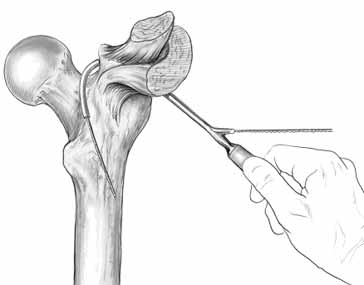 |
| (B) |
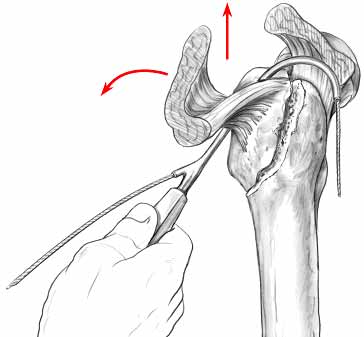 |

Stabilisation du petit trochanter
 Elle
est identique à celle utilisée pour le grand
trochanter. La branche postérieure du passe-câble
doit passer en avant ou à l’intérieur
du tendon blanc du muscle ilio-psoas. Elle
est identique à celle utilisée pour le grand
trochanter. La branche postérieure du passe-câble
doit passer en avant ou à l’intérieur
du tendon blanc du muscle ilio-psoas.
Il peut être nécessaire de stabiliser
le petit trochanter dans trois cas :
A - Le petit trochanter est en place
 Il y
a un risque de déplacement secondaire lorsque le trait
de fracture partiel ou total, habituellement vertical, s’isole
du fût diaphysaire Il y
a un risque de déplacement secondaire lorsque le trait
de fracture partiel ou total, habituellement vertical, s’isole
du fût diaphysaire
B - Le petit trochanter est détaché
de la corticale prolongé en bas par une écaille
de taille variable
 Il faut
dans un premier temps abaisser le petit trochanter pour stabiliser
l’écaille à l’aide du cerclage. Il faut
dans un premier temps abaisser le petit trochanter pour stabiliser
l’écaille à l’aide du cerclage.
C - Le petit trochanter est détaché,
et vient se placer sous le col contre le pôle inférieur
de la tête fémorale
 Il est
parfois fracturé. Il est
parfois fracturé.


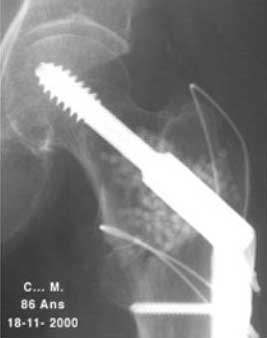
Suture après contrôle
radiologique
On suture le vaste externe.
On met en place un ou deux drains de Redon.
La suture cutanée se fait en trois plans.
Soins post-opératoires
Mise au fauteuil dès le lendemain.
Ablation du drain de Redon au troisième jour en moyenne.
Mise en charge avec déambulateur au dixième
jour en moyenne.
Rééducation passive dès le lendemain.
Contrôles radiographiques au septième jour et
le jour de la sortie.

Utilisation de matériaux
de comblement
 A-
Le biomatériau a un double comportement. Il agit dans
une première phase comme matériau de comblement
à l’intérieur de la métaphyse.
Une résistance mécanique
de 250kg au cm² semble être le meilleur compromis.
Comme il est placé dans une zone aux parois fracturées,
il ne doit pas subir des pressions qui pourraient le chasser
dans les parties molles. A-
Le biomatériau a un double comportement. Il agit dans
une première phase comme matériau de comblement
à l’intérieur de la métaphyse.
Une résistance mécanique
de 250kg au cm² semble être le meilleur compromis.
Comme il est placé dans une zone aux parois fracturées,
il ne doit pas subir des pressions qui pourraient le chasser
dans les parties molles.
Le matériel d’ostéosynthèse doit
donc être stable afin d’éviter l’impaction
du foyer lié au simple tonus musculaire, et lors de
la mise en charge.
 Dans
un second temps, il se comporte comme une véritable
autogreffe. Il va progressivement disparaître sur les
radiographies et se transformer en de l’os qui va reconstituer
le stock osseux à la fois cortical et spongieux. Dans
un second temps, il se comporte comme une véritable
autogreffe. Il va progressivement disparaître sur les
radiographies et se transformer en de l’os qui va reconstituer
le stock osseux à la fois cortical et spongieux.
Lors de toute greffe osseuse il faut respecter la stabilité
de la région gréffée. Seuls les micro
mouvements (évalués entre 0,5 et 2,5mm pour
la consolidation des zones corticales) sont tolérés.
 B-
Les câbles utilisés pour la fixation des tubérosités
vont augmenter la résistance mécanique de l’extrémité
supérieure du fémur. Elle augmente la pression
exercée par la plaque fémorale externe sur la
vis céphalique. En d’autres termes, la traction
exercée par les câbles sur les tubérosités
va par l’intermédiaire de la plaque sur laquelle
ils sont fixés, augmenter la pression au niveau du
foyer de fracture principal. B-
Les câbles utilisés pour la fixation des tubérosités
vont augmenter la résistance mécanique de l’extrémité
supérieure du fémur. Elle augmente la pression
exercée par la plaque fémorale externe sur la
vis céphalique. En d’autres termes, la traction
exercée par les câbles sur les tubérosités
va par l’intermédiaire de la plaque sur laquelle
ils sont fixés, augmenter la pression au niveau du
foyer de fracture principal.
Si la vis n’est pas stabilisée, une impaction
risque de survenir ; ce que l’on souhaite justement
éviter.
 C-
Pour ces raisons, la vis-plaque doit être stabilisée.
Cette stabilisation est obtenue selon le grand axe de la vis
par la bague de diamètre supérieur à
celui de l’orifice de la plaque fémorale externe
et sur l’axe rotatoire par la présence des méplats
de l’âme de la vis céphalique. C-
Pour ces raisons, la vis-plaque doit être stabilisée.
Cette stabilisation est obtenue selon le grand axe de la vis
par la bague de diamètre supérieur à
celui de l’orifice de la plaque fémorale externe
et sur l’axe rotatoire par la présence des méplats
de l’âme de la vis céphalique.

:: Fermer la fenêtre :: |